|
»
bản tiếng Việt
QU’EST CE QUE LA CULTURE ?
Nhân tử
Nguyễn Văn Thọ
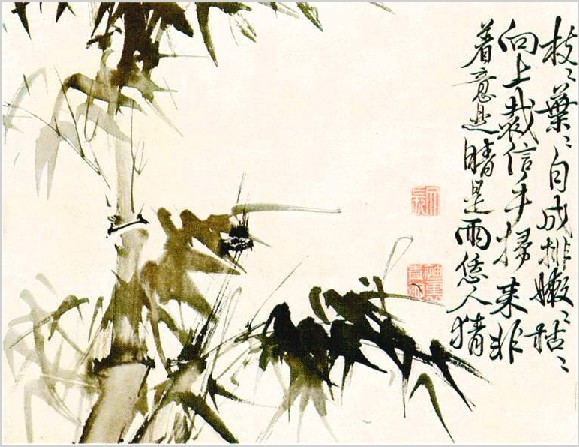
Il y a
quelques années, Mr Phạm Đình Tân formait le projet d’organiser une
série de conférences sur la Culture, et depuis lors il a eu la délicate
attention de m’inviter à causer sur un des sujets de son programme.
Après
maint refus, j’ai dû cependant m’incliner devant son insistance. Il faut
avouer qu’en dépit de mon acceptation, je n’étais pas du tout très
enthousiasmé devant un tel sujet de conférence, sujet aussi aride que le
désert, aussi vague que la brume d’automne, aussi ardu que le chemin qui
menait à Pa-Chou.
Et
aujourd’hui, devant vous entretenir sur un sujet général: QU’EST CE QUE
LA CULTURE, je me sens dans un tel désarroi que me reviennent à la
mémoire ces vers de Kim Vân Kiều:
«Terre
basse, ciel haut, j’implore vos clartés,
Comment
dois-je, à présent, dites, me comporter?»
(Traduction Crayssac)
Comment
m’y prendrai-je donc, quand m’écartant de la voie commune, je me fraye
un chemin à travers les broussailles, et quand sans chercher à évaluer
mes propres forces, je me lance dans des difficultés inextricables.
Puisqu’il
en est ainsi, il ne me reterait que l’unique ressource d’en appeler à
votre extrême indulgence pour m’excuser des erreurs ou lacunes que
j’aurai pu commettre au cours de la présente causerie.
Pour
chercher à comprendre ce qu’est la culture, je m’en vais vous l’exposer,
au fur et à mesure, au cours des cinq rubriques suivantes:
1. Genèse
du terme Culture.
2.
Quelques définitions commentées de la Culture.
3. Étude
étymologique et analytique de la Culture.
4.
Évolution des Cultures. – Trois principales formes culturelles au cours
des âges.
5. Essai
sur une définition de la Culture et sur une conception nouvelle de la
Culture.
☸
I. GENÈSE
DU TERME CULTURE
Avant
d’aborder la culture, il importe de chercher à connaître la genèse du
mot, c’est-à-dire à savoir où, quand, et comment le terme Culture est né
…
Il faut
avouer que c’est là une entreprise très difficile. Malgré mes recherches
ardues, je ne suis pas encore parvenu à avoir une connaissance
parfaitement adéquate du sujet.
C’est
pourquoi, je ne puis aujourd’hui que vous présenter un dossier
provisoire sur la genèse du mot Culture en Occident comme en Orient.
D’après
Bernard Chabonneau, c’était Goethe (1749-1832) qui a donné naissance en
Allemagne, au mot Culture.
«La
Culture, dit-il, naît dans le langage en Allemagne avec la Bildung
Goethienne qui identifie cette culture avec l’humanisme classique, en la
distinguant de la religion et de la pratique économique ou politique.»
[1]
Au
contraire, Harry Levin prétendait que le mot «Kultur» allemand dérivait
du mot Culture français.[2]
Ainsi
seulement au point de vue de l’origine du mot, nous sommes déjà ballotés
entre deux points de vue contraires. Cependant, il est encore beaucoup
plus pénible quand il s’agit de déterminer l’époque et la date de
naissance du mot Culture.
Bernard
Chabonneau soutient qu’en Angleterre et en France, le terme Culture
n’aurait passé vraiment dans le langage courant qu’après 1918.
[3]
D’après
Harry Levin, le mot Culture avec sa signification actuelle, fit son
apparition dans le langage français vers la fin du XVIIIème siècle. La
preuve en est que dans le Dictionnaire Encyclopédique de Diderot, le mot
Culture signifiait seulement «Culture des terres» et n’avait pas encore
d’acception morale.
Ce n’était
en 1777 que le Dictionnaire de l’Académie française ajouta:
«Culture
se dit aussi au figuré, soin qu’on prend des arts et de l’esprit.»
[4]
Ruth Emily
Memury rapporte que dans le langage anglais, le mot Culture apparaît
pour la première fois dans le Dictionnaire Anglais d’Oxford vers 1875.[5]
L’Encyclopédie Britannique soutient que le mot Culture a été déjà
employé au sens figuré, depuis 1869, par Mathew Arnold, dans son livre
intitulé «Culture and Anarchy».
[6]
Selon
Harry Levin, Thomas More a déjà employé, depuis 1510, le mot Culture
dans le sens de l’éducation, de l’entraînement de l’esprit.[7]
Dans ces
conditions, le terme Culture avec son sens figuré, a été crée en quelle
année? 1918? 1869? 1775? ou 1510? en quel siècle? à la fin du XIXème? à la
fin du XVIIIème? ou au début du XVIème siècle?
Qui sera
l’arbitre qualifié pour trancher la question, devant ces différences de
vue, ces décalages chronologiques s’étendant au moins sur quatre
siècles?
Mais les
choses n’en restent pas seulement là. En effet, si nous remontons le
cours du temps, nous verrons que le terme Cultura avec ses sens propres
et figurés a été déjà employé dans l’Empire Romain, plus de 100 ans au
moins avant l’ère chrétienne.
À cette
époque, le terme Culture avait déjà trois significations:
1. L’Art
de cultiver les terres (Agricultura ou Agricultus)
2. L’Art
de cultiver l’âme (animi cultura ou cultus)
3. L’Art
de cultiver l’Esprit (Dei cultura ou cultus)
[8]
Scrutant
l’Orient, nous nous heurtons aux difficultés semblables.
En Chine,
le mot Wen 文 ne signifiait à l’origine
rien de moins que l’ensemble de la Culture humaine.[9]
Un lettré
chinois, Mr. Shih Hsiang Chan écrit: «Le mot chinois qui désigne la
littérature, Wen 文, symbolise aussi
bien dans sa graphie étymologique que dans son premier emploi, l’idée de
la création intellectuelle qui changent les éléments informes en un tout
organique, les contraires en harmonie, le chaos en ordre, donnant ainsi
une forme saisissable au bon et au beau …»
[10]
J. Laloup
et J. Nélis sont aussi d’accord sur ce point:
Selon eux,
le vocable chinois Wen 文 implique tous
les efforts d’humanisation. Ce vocable embrasse la littérature, la
religion, la philosophie, l’art, bref, toutes les acquisitions morales
et spirituelles de l’homme. Il s’oppose donc au vocable Wu 武 qui symbolise les appareils administratifs
et militaires …
[11]
Dans les
Annales de la Chine, le mot Wen 文 ou
Wen-kiáo 文 教 est utilisé aux lieu et
place du mot Wen-hóa 文 化 .[12]
Par
ailleurs, les Rois de cette époque faisaient montre d’une admirable
disposition à faire usage des moyens culturels ou humanitaires dans leur
governement.
L’Empereur Ta-iu 大 禹 par exemple fit étalage des
vertus, des cérémonies et des danses sacrées dans la Cour du Palais
Impérial, en vue d’émouvoir les tribus sauvages Miao 苗 , les incitant à se rallier d’eux-mêmes.[13]
L’Empereur Ou Wang 武 王 après avoir vaincu
Tcheou Wang 紂 王 fit reconduire les
chevaux de guerre au Sud du Mont Houa 華 山 et fit lâcher les boeufs de guerre dans les plaines de Tao-Lin 桃 林, affirmant sa décision de gouverner le
peuple par la Culture et l’éducation (Wen 文 ) de préférence à l’usage de l’appareil militaire et de la
violence (Òu 武 ).[14]
Dans
l’histoire des Trois Royaumes 三 國 誌
(Chine), on note que Fou Kan recommanda à Ts’ao Ts’ao 曹 操 de ne plus mobiliser les troupes contre
les royaumes Wou 吳 et Chou 蜀 , mais de se consacrer plutôt à la
consolidation du pouvoir impérial par le Wen 文 c’est-à-dire par les moyens culturels et humanitaires.
Ts’ao
Ts’ao,
écoutant ces conseils, renonça à ses expéditions contre le Sud, et
s’efforça de développer les écoles et de bien traiter les gens de
lettres.[15]
Ainsi le
mot Wen 文 est vieux au moins de 4000
ans, tandis que le terme Wen-hóa 文 化
n’apparaît dans le langage chinois qu’au début du 20è siècle.
La preuve
en est que dans le Dictionnaire franco-chinois de Séraphin Couvreur,
édité en 1890, en ne voit guère l’ombre du mot Wen-hóa.
Au
Vietnam, étant donné l’influence culturelle de la Chine, le terme Văn
existe aussi depuis longtemps, tandis que le terme «Văn Hóa» n’a
été mis en usage que récemment.
En effet,
aucun dictionnaire vietnamien ou franco-vietnamien édité avant 1918 ne
mentionne ce mot Văn Hóa.[16]
Et dans la
Revue Nam Phong parue depuis 1917, le mot Văn Hóa ne figura, à
moins que je ne me trompe, que dans le No 84 (Année 1924), dans un
article de Thượng Chi intitulé: «Libre
propos sur la culture orientale et la culture occidentale.»
[17]
Bref après
avoir consulté les Dictionnaires français, chinois, vietnamiens et
anglais, nous pouvons conclure, avec une marge de sécurité assez grande,
que le terme Văn Hóa ou Culture est un mot nouveau qui a pris
naissance à la fin du XVIIIème siècle et qui n’a été utilisé couramment en
Orient et en Occident qu’après la première guerre mondiale.[18]
II.
QUELQUES DÉFINITIONS COMMENTÉES DE LA CULTURE
Après
avoir acquis une connaissance sommaire de l’histoire du terme Văn Hóa,
il convient d’en étudier certaines définitions.
Quoique le
terme Culture soit d’un usage très courant, il est cependant difficile
de lui donner une définition adéquate.
Au reste,
chacun a sa façon de concevoir la Culture. C’est pourquoi, le mot
Culture devient protéiforme.
D’aucuns
la font relever de la sphère spirituelle; d’autres la font évoluer sur
le terrain concret et matériel.
Le terme
Culture prend ainsi, un fond et une forme totalement nouveaux et
différents selon les lieux, les époques et les individus.
C’est
pourquoi, bien des gens de lettres hésitent de définir la Culture.
Dans la
Préface de leur livre intitulé «Culture a Critical Review of Concepts
and Definitions», les deux célèbres anthropologues Kroeber et Clyde
Kluckhohn, empruntant les paroles de Lowell ont fait cette confidence:
«Il
m’incombe de parler de la Culture. Cependant, dans ce monde, il n’y a
rien de plus mouvant, de plus fuyant qu’elle.
«On ne
saurait l’analyser, car les éléments en sont en nombre illimité. On ne
saurait la décrire, parce qu’elle est protéiforme. Vouloir la décrire,
vouloir la définir équivaudrait à vouloir attraper l’air avec ses mains.
Résultats: L’air est partout, sauf dans ses poings.»
[19]
Aussi
a-t-on vu de grands écrivains éluder, quand il s’agit de donner une
définition de la Culture.
Lors du
Congrès sur la Culture organisé à Venise du 25 au 31 Mars 1956 par
l’Association de la Culture de l’Europe, auquel ont participé de grands
philosophes, de grands écrivains des pays européens, libres aussi bien
que communistes, entre autres, Karl Barth Campagnolo, J.P. Sartre,
Maurice Merleau Ponty, Vercors, Silone, Fédine, Boris Bolévoi, Kampov,
Jaroslaw-Iwaszkiswicz, etc. on a proposé de ne pas définir la culture
dans le communiqué commun.[20]
Ont
également évité de donner une définition de la Culture, les auteurs de
l’Encyclopédie du Monde Chrétien intitulée le «Bilan du Monde».
Ceux-ci
n’ont pas voulu opposer nettement Culture à Civilisation, mais ont
adopté plutôt le point de vue de Jacques Maritain en disant: «Nous
distinguerons seulement dans la Culture un développement
véritablement humain et donc principalement intellectuel, moral et
spirituel, et dans la Civilisation, l’aspect social, politique et
technique du même développement humain.»
[21]
Thomas
Sterns Eliot, écrivain anglais, prix Nobel de littérature en 1948, a
composé un livre intitulé modestement: «Notes towards the Definition
of Culture» (Notes pour une définition de la Culture).[22]
Ainsi T.S. Eliot lui-même n’entendait pas non plus définir directement
la Culture.
Les
attitudes réservées sus-mentionnées sont en somme très sages, car définir
c’est limiter; or limiter, c’est cirsconscrire, et partant c’est serrer
et gêner…[23]
Au
contraire, les gens communs définisssent la Culture avec une très grande
désinvolture.
A propos,
il est intéressant de noter qu’il y a d’ici plus de 10 ans, Mr Đặng Văn
Ký a fait une entrevue sur la Culture et en vait consigné les réponses
dans le Bulletin de la Culture Orientale, No 9 Mois de
Décembre 1958.[24]
Entre les
deux extrêmes, on trouve d’autres écrivains qui sans être évasifs, ni
désinvoltes, ont eu le courage de définir la Culture. Ainsi grâce à eux,
il nous serait maintenant possible, moyennant recherche, de recueillir
des définitions de la Culture par centaines.
En 1952,
A.L. Kroeber et Clyde Kluckhohn dans leur ouvrage «Culture a Critical
Review of Concepts and Definitions» ont cité plus de 400 auteurs et
ont recueilli 130 définitions de la Culture.[25]
Ici je me
borne à commenter quelques définitions courantes de la Culture.
1.
Culture: Niveau intellectuel
D’Aucuns
prétendent que la Culture est le niveau intellectuel de l’homme. D’où
ces assertions: Un tel est cultivé; un tel ne l’est pas.
D’Après
cette définition, culture équivaut à degré d’instruction.[26]
2.
Culture: Formation intellectuelle et morale
D’autres
conviennent que la Culture est la formation intellectuelle et morale qui
rend l’homme plus noble, plus élevé.
Selon
Thomas Stern Eliot, la Culture est l’amélioration de l’âme et de
l’esprit.[27]
D’après le
Dictionnaire Oxford, la Culture c’est la formation le développement de
l’esprit, des facultés, le raffinement du comportement, etc… La Culture
c’est l’entraînement, c’est l’éducation de l’homme visant à le
perfectionner, à l’ennoblir.[28]
Le
Dictionnaire du Dr Johnson définit la Culture comme l’art d’améliorer, l’art d’évoluer vers la perfection.[29]
Il en
résulte qu’un homme cultivé est un homme noble, bien éduqué, un homme
dont les facultés intellectuelles et morales sont bien développées, dont
le sens artistique est bien formé.
Un homme
cultivé est donc un homme raffiné, noble, vertueux, un homme dont le
livre des Odes a fait l’éloge en ces termes:
«Regardez donc du côté du coude de la Rivière KY,
De
jeunes bambous couvrent de leur verdure, un jardin retiré.
O bel
Homme! Que vous êtes noble et distingué!
On
dirait que depuis bien longtemps, vous avez reçu un façonnage, un
limage, et un polissage parfaits.
O
quelle démarche altière! O quel comportement majestueux!
O sage
accompli! On ne pourra jamais vous oublier.»
[30]
3.
Culture: Education, Système d’éducation nationale
Le terme
Culture dans la langue française, indépendamment de sa signification
ordinaire, veut dire encore instruction, développement.[31]
Le mot
«Culture» est donc lié à celui de l’instruction, de l’éducation, bref à
l’œuvre d’éducation nationale.
Ainsi le
terme culture a une double signification:
a.
Formation morale et spirituelle, formation des hommes vertueux et sages.
b.
Formation intellectuelle, scientifique, et technique; formation des
cadres et des artisans pour la nation.
Ceci
revient à dire que nous et nos ancêtres ont des visées totalement
différentes en ce qui concerne le programme de l’éducation publique.
Autrefois,
en Orient comme en Occident, le but de l’éducation publique consistait à
faire des hommes dignes de ce nom, des sages, des hommes supérieurs: le
programme de l’éducation donnait la primauté à la sagesse.
Aujourd’hui en Orient et en Occident, le but de l’éducation publique est
le développement du savoir humain, la formation des patrons, des
travailleurs, des ouvriers, des techniciens: le programme des études
donne la prééminence à la science et à la technique.
Il va sans
dire que ces deux programmes opposés comportent chacun leurs avantages
et leurs inconvénients.
Le mieux
sera certes, de savoir concilier ces deux visées de l’éducation publique
dans le but de former des hommes à la fois verteux et capables.
Il y a 45
ans, Thượng Chi écrivait dans la revue Nam Phong ces
lignes:
«Un
technicien sans principes moraux est semblable à une peau de fruit sans
pulpe ni noyau. Il lui est impossible de réaliser une vie idéale.
«Par
contre, un sage sans formation technique et professionelle est semblable
à un noyau de fruit sans peau. Il lui est bien difficile de lutter pour
la vie.
«C’est
pourquoi, il est nécessaire de concilier la science avec la sagesse;
l’intérêt public avec la perfection morale. C’est ce qu’on appelle
synthèse des deux Cultures orientale et occidentale.»
[32]
4. Culture:
Belles-Lettres et Arts
Il y a des
gens qui prennent Culture pour Belles-Lettres et Arts.
C’est là
une des définitions de la Culture la plus en vogue.
Actuellement d’ailleurs, Culture, Belles-Lettres et Arts marchent
souvent de pair comme un objet et son ombre.
En effet,
Arts et Belles-Lettres constituent des instruments pour la diffusion de
la Culture, des traits d’union entre les hommes, des moyens de
transmission et de conservation de la Culture.
De même
que l’homme a deux tendances: l’une orientée vers l’idéal, vers la
transcendance, vers l’universalité, vers l’intemporel; l’autre tournée
vers les réalités temporelles, historiques, sociales, spatiales et
naturelles, de même, la Culture ainsi que les Belles-Lettres et les Arts
possèdent deux orientations, deux aspects.
Ainsi, les
hommes de culture supérieurs se servent de la littérature et des arts
pour brosser à l’intention de la masse, des plans supérieurs de la vie,
des phases supérieures et lointaines de l’évolution humaine, bref une
vie idéale et parfaite.
Les hommes
de culture ordinaires, les écrivains et les artistes ordinaires font
usage de la littérature, de l’art, de leurs talents pour embellir et
égayer la vie des gens. Ou bien, ils à cherchent à enregistrer les
scènes bigarrées et changeantes de la vie sociale et sentimentale; à
exprimer leurs sentiments intimes et les sentiments de la masse; à
décrire les vissicitudes de la vie, les cruautés de l’existence; à
étaler les sentiments refoulés de la masse; à traduire la joie profonde
des hommes ou visualiser les aspirations et les rêves des générations.
Bref, ils veulent répertorier les bons et les mauvais aspects de toutes
les circonstances, brosser la physionomie réelle des hommes vivant dans
des cadres historiques ou géographiques déterminés. Ils veulent, en
somme, que leurs écrits et leurs oeuvres puissent servir de modèle, de
motifs de persuasion ou de dissuasion, aidant ainsi les gens à mieux se
conduire dans les multiples circonstances de la vie, à mener, pour tout
dire, une vie belle et heureuse.
Définissant le Culture comme Belles-Lettres et Arts, beaucoup de gens
infèrent que la Culture est inférieure à la Religion. Pour eux, la
Religion, c’est la Foi, le Sacré, la Sainteté, l’Expression divine, la
Parole de Dieu, tandis que la Culture serait plutôt le Savoir humain, le
Profane, le Reflet de la vie humaine, l’Humanisme en somme.[33]
Pourtant,
à bien considérer, le mot Culture est un terme beaucoup plus générique,
beaucoup plus vaste que le terme Religion.
En effet
chaque fois qu’on aborde le problème de la Culture, d’un pays donné, on
parle non seulement de la religion, mais encore d’autres sujets tels que
littérature, arts, régime politique, fêtes et réjouissance etc …
Les
politiciens de leur côté, ayant assimilé la Culture aux Belles-Lettres
et aux Arts, ou la considérant dans leur for intérieur comme un pur
passe-temps, ont voulu dissocier Culture et Politique.
Ils sont
prêts à assumer le rôle de mécènes, de protecteurs à l’égard des gens de
lettres, pourvu que ces derniers s’entretiennent des questions oiseuses,
qu’ils creusent le passé, qu’ils rêvassent sur l’avenir, qu’ils
s’attaquent aux idéologies antagonistes, mais qu’ils encensent et
soutiennent le régime actuel, suggèrent à tous de se laisser vivre
paisiblement dans le statu quo sans faire de réclamations, sans demander
d’améliorations, ni de réformes.
Cependant,
la Culture englobe effectivement la politique. Elle n’est pas
l’instrument de la politique; par contre, la politique est plutôt
l’instrument de la Culture, tout régime politique n’étant que la
réalisation d’une certaine forme de Culture, d’une certaine idéologie.
5.
Culture: Activité spirituelle. – Civilisation: Activité matérielle et
physique
D’autres
soutiennent que la Culture englobe toutes les activités morales et
spirituelles tandis que la civilsation recouvre toutes les activités
matérielles et physiques. Ainsi Religion, Morale, et Art relèvent de la
Culture; Technique et Science relèvent de la Civilisation.[34]
Tout ce
qui est beau, c’est Culture. Tout ce qui est utile, c’est Civilisation.
Mais la
réalité n’est pas aussi simple.
On a
beaucoup discuté sur les domaines respectifs de la Culture et de la
Civilisation.
D’aucuns
prétendent que la Culture relève du domaine spirituel, et que la
Civilisation ressort du domaine matériel et technique. (La majorité des
hommes de lettres allemands et américains)
[35]
D’autres
estiment que Culture prime Civilisation. (Conception des hommes de
lettres orientaux)[36]
Certains
anthropologues soutiennent au contraire que Civilisation l’emporte sur
Culture.[37]
Certains
anthropologues soutiennent que la civilisation n’est qu’un composant de
la culture, alors que d’autres sont d’avis diamétralement opposé. (I.
Olaguë par exemple)
[38]
Certain
savants pensent que Culture et Civilisation sont des termes synonymes et
par conséquent interchangeables, se référant toutes deux à un mode de
vie noble et supérieur.
Dans une
conférence sur les Cultures et les Civilisations tenue à Salzburg du 8
au 15 Octobre 1961,[39]
à laquelle avaient participé d’illustres gens de lettres tels que
Sorokin, Toynbee, Spengler, Northrop, etc… on employait indifféremment
Culture et Civilisation, leur donnant la même signification.[40]
Toynbee
justifie cette manière d’agir en disant que la différence de sens entre
Culture et Civilisation n’existe que dans la langue allemande où Culture
veut dire progrès spirituel, civilisation veut dire progrès matériel
alors que dans les langues française et anglaise, cette distinction
n’existe pas. C’est pourquoi la Conférence a employé le mot Civilisation
avec la double signification comme Culture et comme Civilisation.[41]
Les débats
et les divergences de vues concernant Culture et Civilisation font
ressortir clairement les faits suivants:
(1) D’une part, l’homme doit
évoluer moralement et spirituellement pour s’ennoblir, pour se
perfectionner et pour rendre les autres semblables à lui-même au point
de vue de perfection.
(2) D’autre part, l’homme
doit améliorer sa situation, son milieu pour que sa vie soit plus belle,
plus gaie, plus heureuse.
(3) Bref, l’homme doit se
perfectionner, se développer à tous les points de vue, dans tous les
domaines.
(4) Partant, ceux qui ne
s’efforcent pas d’évoluer, de s’améliorer, d’améliorer leur situation,
se contentant de jouir, de vivre au jour le jour, ceux-là seront écartés
du mouvement général d’évolution, et ne contribuent en rien à l’oeuvre
d’édification de la Civilisation et de la Culture.
(5) À bien
réfléchir, la Civilisation et la Culture ne sont que des processus
d’épuration, de perfectionnement de l’homme, ennoblissant, purifiant,
améliorant, exaltant tout ce qui laisse encore à désirer.[42]
(6) Cette œuvre de
perfectionnement s’effectue simultanément ou successivement sur deux
plans différents: spirituel et matériel.
(7) A première vue, ces deux
états de chose semblent s’opposer l’un à l’autre. Mais à bien
considérer, ils contribuent tous deux à la «Grande Œuvre» de la nature:
Œuvre de perfectionnement, de sanctification voire même de divinisation
des hommes.
Le I
Ching a dit à ce sujet:
«Le
Ciel et la Terre s’opposent l’un à l’autre,
Pourtant ils participent à la même tâche,
Garçon
et fille s’opposent, mais ils sont dotés d’une même volonté.
Tous
les êtres s’opposent, mais coopèrent à une même œuvre.»
[43]
S’opposer
l’un à l’autre, lutter l’un contre l’autre, se concurrencer
mutuellement, c’est simplement pour promouvoir des transformations
lesquelles permettront aux hommes «d’atteindre leur vraie nature, de
réaliser leur destin grandiose et d’accéder à l’harmonie universelle.»
[44]
Gosala, un
philosophe indien, a dit de même:
«Tout l’univers progresse
sur le chemin de l’évolution au cours de laquelle l’humanité entière le
fou comme le sage, en obéissant à la loi prédéterminée de la nature,
peut atteindre la perfection d’une façon spontanée sans fournir
d’effort, grâce à une transformation graduelle.»
[45]
6.
Culture: Activité créatrice
Certains
mettent l’accent sur l’activité créatrice dans la Culture et prétendent
que Culture signifie activité créatrice.
Campagnolo
soutient que la Culture est la création des valeurs qui ne sont ni la
reproduction, ni la dérivation des valeurs existantes, mais s’orientent
toujours vers le renouvellement.[46]
Francisco
Roméro, un écrivain espagnol, définit la Culture comme la vie de
l’Esprit, la création incessante de l’esprit qui s’objective par la
littérature, les arts, la science, la philosophie, les us et coutumes et
les règles de convenance sociale.[47]
7.
Culture: ce qui est partagé et transmis
D’autres
disent que la Culture peut se définir essentiellement par ce qui est
partagé et transmis.
S’il en
est ainsi, la culture est un phénomène social consistant en appels et en
réponses, en participation collective.
La culture
n’est pas un bien personnel, mais collectif.
Si la
Culture est quelque chose de partagé, de transmis qui doit être assimilé
et sauvegardé à travers les âges, on comprend qu’un homme de culture qui
a des vues erronnées, des idées fausses nuira à plusieurs générations.
Cette
considération devrait inciter les promoteurs de la culture à être très
dirconspects dans leurs pensées et dans leurs paroles.
A propos,
il est bon de nous rappeler les paroles du I Ching:
«L’homme
supérieur restant chez lui, prononce-t-il de bonnes paroles, à plus de
mille lis à la ronde, on lui répond sympathiquement; combien à plus
forte raison, ceux qui sont proches! Restant chez lui, prononce-t-il de
mauvaises paroles, à mille lis à la ronde, on s’écartera de lui; combien
à plus forte raison, ceux de son voisinage! La parole une fois exprimée
agit sur le peuple; l’action une fois déclenchée a des répercussions
dans le lointain.
Les
paroles et les actes d’un homme sont donc des mécanismes qui une fois
mis en branle, vont tôt ou tard engendrer soit l’honneur soit l’opprobe
à leur auteur.
On
comprend alors que les paroles et les actes du sage suffisent à ébranler
le ciel et la terre. C’est pourquoi, il doit être très circonspect dans
ses paroles et dans ses actes.»
[48]
8.
Culture: Tout ce qui rend la vie plus belle
Certains
estiment que la Culture englobe tout ce qui rend la vie plus belle, plus
charmante, plus colorée, plus attrayante, bref, tout ce qui la rend plus
pictoresque, plus poétique, plus digne d’être vécue.
Eliot
écrivait: «À l’égard de la société, la Culture englobe toutes les
activités spécifiques d’un peuple, comme pour les Anglais le jour de
course à Derby, la compétition des voiliers à Henley, la compétitition
des yatchs à Cowes, le 12 Août, les courses des chiens, le jeu de
lancement des flèches, ou le fromage de Wensleydale, le chou cuit coupé
en tranches, la betterave marinée dans le vinaigre, les églises
gothiques du XIXè siècle et la musique d’Elgar.»
[49]
S’il en est ainsi, sont
effectivement des manifestations de la Culture: les chansons populaires
qui s’exhalent plaintivement des champ de riz, les élégies qui
s’égrènent mélodieusement sur les flots des rivières; les cabanes en
bambou qui se profilent éparses sur les flancs des montagnes; qui
perchent indécises entre des rangées de sapins, de pêchers et de saules;
qui se profilent noyées dans la fumée, dans les nuages, ou illuminées
par les derniers rayons du soleil couchant; les festivités; les
réjouissances; les pans de robes de soie brodées qui flottent au gré des
vents… Toutes ces choses sont bel et bien des manifestations de la
culture au même titre que les sermons, les homélies, ou les leçons de
morale prononcés dans les églises ou dans les écoles; au même titre que
les palais, les châteaux, les monuments architecturaux antiques ou
modernes qui s’élancent arrogamment vers le ciel comme pour lancer un
défi aux intempéries…
9.
Culture: Evolution vers l’idéal
D’aucuns conçoivent que la
Culture est l’évolution de l’humanité de l’état brut à l’état raffiné;
l’effort déployé par elle pour tendre vers une vie idéale, et toutes les
réalisations acquises au cours de ce processus.
Ainsi, les
Hindous désignent la Culture par le vocable de Sanskrit, mot dont
racine veut dire purifier, transformer, exalter, façonner et
perfectionner.
Un homme
cultivé est pour eux un home qui s’est soumis à une discipline, qui est
parvenu à maîtriser ses instincts et qui s’est façonné lui-même
conformément à la morale.[50]
Arnold
soutient que la culture est l’effort déployé par l’homme pour parvenir à
un niveau de vie plus élevé, pour tendre vers la perfection.
Les moyens
pour réaliser cette ascension sont précisément fournis par la
littérature, les arts, l’étude des pensées et gestes de nos célèbres
prédécesseurs.[51]
Arnold
distingue dans la culture deux éléments constitutifs:
a.
l’effort fait par l’homme pour parvenir à la perfection.
b. tous
les livres, tous les documents de valeur que nous lèguent nos devanciers.[52]
Nguyễn
Đăng Thục associe Culture et évolution. «La Culture, dit-il, signifie
Évolution. Elle progresse de l’état brut à l’état raffiné; du vil au
noble; du matériel au spirituel.»
[53]
Tous les
penseurs précités, quoique s’exprimant différemment, soutiennent tous
que la Culture est un processus d’humanisation, de sublimation; un
effort d’évolution vers l’Être, vers l’Idéal.[54]
C’est là
aussi une des conceptions classiques et traditionnelles de la Culture.[55]
10.
Culture: Mode de vie d’un peuple, d’une société
Les
sociologues, les ethnologues, de leur côté, cherchant à éviter l’emploi
du mot «esprit», condammant toute subjectivité et toute finalité, se
bornent à définir la Culture comme le mode de vie d’un peuple, d’une
société humaine. Malinowski, par exemple, décrète qu’en étudiant la
Culture, on étudie tout un mode de vie d’une société.[56]
Henri de
Man soutient que la «Culture» est une configuration de la vie reposant
sur la croyance commune à une hiérarchie de valeurs déterminées. Cette
hiérarchie de valeurs donne à la vie une signification précise.[57]
Linton a
une conception similaire: «La culture d’une société, dit-il, est le mode
de vie de ses membres. C’est l’ensemble des idées et des habitudes
qu’ils acquièrent, partagent et transmettent de génération en
génération. La culture fournit aux membres de chaque génération des
solutions efficaces et toutes prêtes pour la plupart de problèmes qui se
poseront vraisemblablement. Ces problèmes sont eux-mêmes soulevés par
les besoins d’individus vivant au sein d’un groupe organisé.»
[58]
Il
s’ensuit que la Culture n’est pas seulement un mode de vie, mais elle
encore une conception de la vie.[59]
Toute une
école de sociologues anglo-saxons a été conduite à donner une définition
de la culture. Pour eux, le mot Culture qui évoquait le raffinement
intellectuel et moral, le développement des arts, désigne maintenant
maintenant la totalité des comportements de tout un peuple.[60]
Ainsi à
l’égard des anthropologistes, le mot Culture prend aujourd’hui une
signification toute nouvelle. Jadis la Culture consistait en un esprit
et des œuvres qui se distinguaient de la pratique et du quotidien. Elle
était l’idéal, la vie idéale du genre humain.[61]
Aujourd’hui, on estime que la Culture est seulement le reflet de la vie
réelle et quotidienne avec ses qualités et ses défauts.[62]
Bien plus,
les anthropologistes, au nombre desquels se trouve Claude Lévi Strauss,
tendent à rejeter de plus en plus l’ancienne conception étroite selon
laquelle seule «notre culture» est bonne à l’exclusion de toutes les
autres; seule la culture moderne est bonne au détriment de toutes les
autres cultures anciennes.
Pour eux,
une telle conception est maintenant périmée. Et l’on est amené à
reconnaître que jadis comme aujourd’hui, c’est toujours le même homme,
la même raison, le même sentiment, les même capacités qui entrent en
jeu; c’est seulement par suite des temps différentes, des circonstances
différentes, des conceptions de vie différentes, qu’on a des
comportements différents, des modes de vie différents, des organisations
et des institutions différentes.
Cette
conception nous fait penser à la fameuse distique relatant le dialogue
historique entre les deux gens de lettres vietnamiens sous la dynastie
de Gia Long:
«Qui sera
marquis, qui sera général, dans ce monde changeant, comment peut-on le
savoir à l’avance?
«À
l’époque de Tchén Kouo comme à l’époque de Tchén Kouo; à
l’époque de Tch’ouen Ts’iou comme à l’époque de Tch’ouen
Ts’iou, on doit toujours se plier aux injonctions des
circonstances.»
[63]
D’ailleurs, on a commencé aujourd’hui à étudier les cultures avec plus
de compréhension et d’ouverture, s’attachant à découvrir les divergences
dues aux effets du temps, de l’espace, et des actions humaines; comme
aussi à découvrir les points de vue communs, essentiels et universels
cachés sous le voile bigarré des manifestations extérieures .[64]
D’ailleurs, on est obligé de reconnaître que depuis la période
préhistorique même, il existait déjà de hautes cultures. Et c’est une
erreur de croire que la Culture datait seulement de la période
hellénistique. L’attestation de cette ancienneté est prouvée notamment
par la découverte des peintures murales extrêmement réussies, faites par
des primitifs dans les grottes de l’Europe, à Altamira (Espagne), à la
Meuthe (Dordogne-France), à Pont de Gaume ou à Lascaux.[65]
Bien plus,
des anthropologietes comme Claude Lévi Strauss, ont osé même avancer que
la Culture du Néolithique était une des meilleures Cultures depuis
l’origine jusqu’à nos jours.[66]
Notre
étude sémantique de la Culture en a ainsi fait ressortir un certain
nombre de définitions:
1. La
Culture c’est le niveau intellectuel, le savoir d’un homme.
2. La
Culture c’est la formation intellectuelle et morale de l’homme.
3 La
Culture c’est l’œuvre éducatrice de l’homme, le système d’éducation
nationale.
4. La
Culture c’est Belles Lettres et Arts.
5. La
Culture c’est l’activité de l’esprit, par opposition à la Civilisation.
6. La
Culture c’est la création de nouvelles valeurs.
7. La
Culture c’est tout ce qui partagé et transmis.
8. La
Culture c’est tout ce qui donne à la vie plus de sens, plus de poésie et
de valeurs.
9. La
Culture c’est l’évolution vers l’idéal.
10. La
Culture c’est un mode de vie spécial d’une société, d’un peuple.
Ces
diverses définitions se ramènent à un certain nombre de rubriques:
1. La
Culture englobe et le Divin et l’Humain. Elle embrasse religion, morale,
philosophie, Lettre et Arts.
2. La
Culture est simplement tout de qui est Humain, et partant elle diffère à
la fois de la religion et de la civilisation.
3. La
Culture comprend à la fois l’humain et le physique. Elle embrasse donc
Humanités et Sciences; Littérature et Technique. Elle est à la fois
Culture et Civilisation.
4. La
Culture est tout. Elle englobe religions, arts, littérature, politique,
science, technique etc…
Nous
voyons donc que la Culture est un terme dont le fond varie avec les
points de vue de l’auteur.
Étudiée au
point de vue finaliste, la culture apparaît comme l’évolution de l’homme
vers la perfection.
Considérée
au point de vue empirique et utilitaire, la Culture est la formation de
l’homme pour le rendre apte aux besoins des différentes époques.
Théoriquement, la Culture est une conception de vie.
Pratiquement, la Culture est un style de vie particulier d’un peuple à
une époque donnée, dans des cirsonstances données.
Nous
pouvons donner à la Culture une teinture idéologique. Ainsi nous disons:
Culture confucéenne, Culture catholique, Culture bouddhique, Culture
musulmane, Culture communiste etc…
Nous
pouvons décrire la Culture en termes philosophiques. Nous disons par
exemple: Culture spirituelle, Culture matérialiste…
Nous
pouvons encore qualifier les Cultures différemment selon les tendances
prédominantes de chaque époque. Ainsi nous disons: Culture humanitaire,
Culture technique.
Nous
pouvons aussi catégoriser les Cultures différemment selon les inventions
majeures et catactéristiques des temps historiques. Nous disons: Culture
paléolithique, Culture mésolithique, Culture Néolithique…
Nous
pouvons enfin mettre à contribution les points cardinaux, la géographie,
les nationalités, les races pour classifier les Cultures. Nous disons
par exemple: Culture orientale, Culture occidentale, Culture chinoise,
Culture française, Culture vietnamienne, Culture Champa etc.
En somme,
toutes les écoles, toutes les tendances reconnaissent que la Culture
englobe touts les efforts, toutes les méthodes visant à améliorer la
condition humaine, à développer les potentialités humaines; qu’elle a
pour but de transformer, de rénover, de façonner l’homme.
La Culture
donne toujours à l’homme une orientation, une prise de position
déterminée.
Synthétisant tous les points de vue sus-mentionnés, nous pouvons
conclure que:
(1) La Culture est un mode
de vie particulier d’un individu, d’un groupe, d’une société, d’un
peuple.
(2) Elle est née des idées,
des sentiments, des tendances, spéciales qui serviront à la fois
d’armature sociale et de principes directeurs.
(3) Elle se manifeste et se
concrétise grâce à la littérature, aux arts, à la religion, à la
politique, à la vie sociale.
(4) Elle s’identifie avec le
vie quotidienne grâce aux coutumes, lois règlemants, organisations,
modes d’habillement, instruments caractéristiques.
(5) Elle peut être
transmise, conservée par le langage, la tradition l’instruction.
(6) Elle est l’ensemble des
efforts déployés par l’homme pour sa propre amélioration, pour
l’amélioration de la famille, de la nation de la société, aux fins de
s’assurer une vie bien différente des bêtes, une vie noble et digne, une
vie, si possible, libre, heureuse, idéale, et sainte.
(7) La Culture a pris
naissance dans la vision du Vrai, du Bien et du Beau. Elle est l’effort
déployé par l’humanité pour tendre vers le Vrai, Le Bien et le Beau.
Elle a pour but de réaliser le Vrai, le Bien et le Beau…
III.
ETUDE ETYMOLOGIQUE ET ANALYTIQUE DE LA CULTURE
Après
avoir commenté, les diverses significations de la Culture, nous allons
approfondir le sujet, cherchant à en étudier l’étymologie et les
éléments constitutifs.
A.
Etude étymologique
1. Tout
d’abord, analysons le terme Culture. La Culture, d’après son sens
propre, veut dire action de cultiver. C’est donc l’ensemble des
procédés, des travaux, propres à favoriser la croissance des plantes,
des céréales. Ce sont là des méthodes, des techniques extrinsèques ayant
pour but de développer les possibilités innées et intrinsèques des
plantes et des céréales.
Pareillement, la Culture, au sens figuré, englobe toutes les méthodes,
toutes les techniques extrinsèques ayant pour but de développer les
facultés innées et intrisèques de l’homme.
Autrement
dit, la Culture aide à la croissance, au développement des talents et
des facultés qui existent à l’état latent dans l’homme.
Le
problème ainsi clairement posé, nous voyons immédiatement que les
philosophes, évolutionnistes, comme Herbert Spencer, sont dans l’erreur
quand ils soutiennent que rien n’est inné, et que tout est acquis,
autrement dit, que l’homme évolue d’une manière ou d’une autre,
exclusivement selon l’influence du milieu et de la société.[67]
Dans le No
84 de la Revue Nam Phong, Phạm Quỳnh a employé la terminologie réservée
à la Culture au sens propre commenter la Culture au sens figuré.
Il écrit:
«Qu’est-ce
que la Culture? La Culture est la formation, l’amélioration de l’esprit
et de l’intelligence des hommes; la réalisation des œuvres grandioses,
des entreprises d’envergure qui contribuerent au prestige de la nation.
«Si l’on
assimile l’homme à une plante, la Culture est donc la façon de planter,
de fertiliser, d’arroser «cette plante humaine» pour qu’elle puisse se
développer, fleurir et fructifier, embellissant ainsi le grand jardin de
l’univers.»
Et il
ajoute:
«Les
germes Hồng, les bourgeons Lac, autrement dit, nous autres Vietnamiens,
nous ne sommes pas des herbes vulgaires, que produit la nature. Pourquoi
alors, nous laissons-nous dépérir, faute de soins et de culture
adéquate?
«S’il en
est ainsi, c’est que nous n’avons pas encore trouvé une méthode de
culture rationnelle.
«En effet,
si nous continuons à pratiquer les méthodes anciennes, nous n’obtenons
que des pièces rabougries, minuscules, propres tout au plus à être
exposées comme plantes d’agrément dans des pots de faïence, dans des
bassins en miniature.
«Si l’on
veut au contraire, appliquer les méthodes nouvelles, on n’obtient hélas
que des espèces de plantes parasites qui ne végètent que grâce aux
grands arbres auxquels elles s’accrochent. Mais une fois détachées de
leurs tuteurs, faibles et molles qu’elles sont, vivront-elles?
«Les gens
d’élite de notre nation sont maintenant hélas comparables à ces plantes
parasites, à ces plantes d’agrément, comment pourront-ils donc obtenir
une brillante situation dans le monde?»
Il
poursuit:
«La
Culture est l’ensemble des méthodes tendant à forger l’esprit de
l’homme. Le terme Văn Hóa est la traduction du terme français «Culture»
qui au sens propre signifie l’art de cultiver.
L’homme
étant assimilé à une plante, la culture consiste donc à faire épanouir
toutes ses facultés. La plante devient belle, si elle est bien cultivée
et soignée; l’homme devient meilleur s’il est bien éduqué
»
2.Étudions
maintenant le vocable sino-vietnamien Văn Hóa.
Etymologiquement, celui-ci peut-être interprété de trois façons:
a. Agir
sur autrui par le Beau.
b. Seul
ce qui est beau peut toucher l’homme.
c.
L’accès à la beauté et là noblesse se fait grâce à l’évolution.
(a) Tout
d’abord, si Culture veut dire utilisation du Beau pour agir sur autrui,
il est évident que la Culture va englober littérature et art; tout ce
qu’il y a de meilleur dans l’humanité, acquis et transmis à travers les
âges comme contributions spécifiques et héritage précieux de chaque
génération.
Nous
comprenons alors pourquoi depuis toujours, on a recours aux lettres et
aux arts pour agir sur les hommes.
(b) Le
Beau est susceptible d’émouvoir l’homme. Si l’on s’en tient à cette
explication, on peut scinder l’humanité en deux groupes:
(1) Une minorité comprenant
des hommes cultivés, distingués, évolués.
(2) Une majorité comprenant
des hommes grossiers, arriérés.
Le premier
groupe doit guider, transformer le second groupe. D’où de dicton:
«L’évolué doit instruire l’arriéré».
Qui plus
est, les hommes de Culture, devraient être des hommes polis, distingués
et nobles non seulement dans leur comportement et dans leurs œuvres,
mais encore en âme et en esprit. Ce n’est qu’à cette condition, ils
peuvent influer profondément sur les autres.
(c) Le
terme Văn Hóa peut également être compris comme il suit: «L’accès au
beau suppose des transformation préalables».
S’il en
était ainsi, ne craignons plus de nous transformer. Cependant, nous
évoluons, non pas n’importe comment, mais seulement vers une vie plus
digne, plus belle, plus heureuse, plus libre et plus généreuse.
Il
s’ensuit que la Culture est la somme des efforts déployés par l’homme
pour transformer tout aussi bien le milieu environnant que son âme et
son esprit, pour s’assurer le bonheur, la noblesse, la beauté à tous les
points de vue.
Dans ces
conditions, sera donc une œuvre de culture, la transformation, par
exemple, du désert en terre fertile, en rizières et en vergers
florissants, apportant au pays richesses, prospérité, et magnificence.
Si avec un
pinceau et des couleurs, un peintre fait surgir de la toile ou du papier
des paysages féériques, il aura accompli une œuvre du culture. À plus
forte raison, ceux qui, à la sueur de leur front ou grâce à leurs
talents, œuvrent pour le bien de leur pays et du monde entier, ceux-là
ne sont-ils pas à just titre des gens de culture éminents?
Si culture
veut dire transformation et amélioration des choses de ce monde, alors,
un politicien ou un sociologue qui par son action eût réalisé pour
l’humanité une vie belle, heureuse, libre et prospère, celui-là serait
aussi un homme de culture éminent.
Si un
artiste, mettant à profit sa voix merveilleuse, ses rares talents pour
égayer momenttanément ses semblables, peut être appelé un homme de
culture, combien ne le seront-ils pas, à plus forte raison, ceux qui
parviennent à faire naître aux 1èvres des jeunes filles des sourires
spontanés, à favoriser un heureux épanouissement de vie sur les visages
de leurs concitoyens, à tarir la source de tristesses humaines, à
répandre le bonheur sur la terre!
Si par
transformation, on obtient le beau, le parfait; si nous pouvons agir sur
le milieu extérieur pour l’embellir, nous pouvons de même agir sur notre
for intérieur pour le perfectionner.
D’ailleurs, nous tous, nous avons une réserve inépuisable de belle
potentialités qui n’attendent qu’à être travaillées, transformées, pour
se manifester, pour s’épanouir pleinement.
Concevoir
ainsi la Culture, c’est envisager pour nous un avenir sans limite, une
perspective parfaitement belle.
Nous
voyons donc que le but de la Culture est non seulement de nous aider à
obtenir des améliorations d’ordre extérieur, matériel, social et
corporel, mais encore et surtout d’apporter à notre âme et à notre
esprit tous les attraits d’une beauté sublime, surnaturelle, nous
permettant d’accéder à la dignité des saints, des dieux.
La
responsabilité la plus lourde, la mission la plus noble pour un homme de
culture consistent à réaliser pour lui-même comme pour ses semblables ce
suprême objectif.
Bref:
Tout
l’univers est mis au service de l’homme,
Fils de
l’homme maintenant, nous serons des fils de Dieu dans l’avenir.
Accédons
au sanctuaire de notre âme, et nous verrons se dévoiler les grands
mystères de Dieu et les grandes merveilles de la Nature.
Qu’il n’y
ait plus de dissensions entre l’Orient et l’Occident!
Apparement
en effet, nous appartenons à des nations différentes, mais
essentiellement, nous sommes un.
Oublions
alors montagnes et mers, oublions barrières et séparations.
Unissons-nous en un seul corps mystique et la paix va régner partout …
B.
Analyse structurale de la Culture
Notre
étude étymologique de la Culture a fait suffisamment ressortir que ce
vocable est très riche en significations.
En effet,
la Culture, comme nous l’avons vu, englobe, en fait, toutes les activité
humaines considérées comme des efforts tendant à réaliser une vie
toujours plus belle, plus noble, plus parfaite.
Nous avons
ainsi donné au vocable Culture plus de vitalité et plus de
potentialités. Nous avons ainsi en perspective une vie future pleine de
promesses, une vie idéale et parfaite qui pourtant n’appartiendrait pas
au monde des chimères, mais que nous tâcherons de réaliser, en y
convergeant tous nos efforts, nos activités et nos aspirations
légitimes.
En
élargissant ainsi les horizons de la Culture, nous n’avons pas fait
fausse route, car les linguistes, les sociologues et les ethnologues ont
fait de même.
Sorokin
par exemple, note que la Culture comprend:
1- Le Langage
2- La Science
3- La Religion
4- La
Morale.[68]
L’Encyclopédie Britannique, dans sa 9ème édition, remarque que la
Culture englobe: Religion, Politique, Littérature, Science, Philosophie,
Arts, Musique, etc
[69]
Lý Đảnh
Thịnh dans son dictionnaire Hiện đại dụng ngữ từ điển
(Dictionnaire des termes courants contemporains), divise les éléments de
la Culture en trois catégories structurales:
1- Les infrastructures
matérielles.
2- L’organisation sociale.
3- La vie
spirituelle.[70]
Félix
Sartiaux et Đào Duy Anh décomposent la Culture en:
1- Vie économique
2- Vie sociale
3- Vie
intellectuelle.[71]
Đào Duy
Anh précise que la Culture n’est rien autre que l’ensemble des moyens
d’existence de l’espèce humaine, c’est pourquoi on peut déclarer que la
Culture n’est rien autre que la vie.[72]
Ainsi au
fil des temps, le domaine de la Culture s’est élargi immensément à tel
point qu’elle englobe toutes les activités humaines.
Si donc on
tentait d’enfermer la Culture dans un cadre défini, on se heurterait
certainement à de grandes difficultés.
Après
mûres réflexions, il serait extrêmement difficile d’assigner un cadre
quelconque à la Culture, car si la Culture est l’ensemble des efforts
déployés par l’homme pour bien vivre, pour mieux être, alors tous les
efforts qui tendent à réaliser une vie confortable, généreuse, à donner
à la société une organisation juste, des divertissements sains, des
festivités, des réjouissance communes, ces efforts-là ne sont-ils pas
des activités culturelles au même titre que les principes et les leçon
morale?
Cette vue
générale et globale nous aide à comprendre pourquoi certains associent
Culture et Religion, Culture et Politique, Culture et Civilisation alors
que d’autres dissocient Culture et Religion, Culture et Politique,
Culture et Civilisation.
Ces prises
de position résultent en effet de ce que l’on veut ou non donner une
limite à la Culture.
L’Analyse
structurale de la Culture, comme l’ont fait Lý Đảnh Thịnh, Felix
Sartiaux, et Sorokin est certainement très pratique pour l’étude de la
Culture. Cependant, elle ne fait pas resortir l’enchaînement causal
entre les différents facteurs de Culture.
Pour faire
ressortir cet enchaînement causal, on pourrait diviser la Culture aussi
en 3 parties, mais d’une autre façon.
Pour nous,
la Culture englobe:
1. Les
principaux concepts concernant l’univers et l’homme, en un mot, une
conception générale de la vie (Weltanschauung).
2. Les
méthodes qu’on emploie pour diffuser cette conception de la vie et
l’appliquer à la vie sociale courante.
3. Le
style de vie d’une communauté, d’une société, se modelant sur cette
conception de vie.
Grâce à
cette distinction, nous voyons que la culture est en somme un mode de
vie particulier à une région, à un peuple ou à une société. Elle
comprend:
1. Une
conception de la vie caractérisée par des idées essentielles et
directrices d’ordre religieux, moral ou philosophique.
2 Les
méthodes visant à l’expression et à la diffusion de ces idées, de cette
conception de la vie, englobant en somme tous les moyens de propagande
et de vulgarisation: littérature, art, musique, cinéma; bref, tous les
procédés de persuasion, d’information et de propagande susceptible de
capter les masses.
3 Les
modes de vie d’un peuple en conformité plus ou moins grande avec ces
idées-forces: comportement et réactions quotidiennes, us et cotumes,
cérémonies et rites, régissant les activités individuelles et sociales
de ses membres depuis la naissance jusqu’à la mort.
IV.
L’EVOLUTION DES CULTURES – LES TROIS FORMES CULTURELLES AU COURS DES
ÂGES
A.
L’Evolution des cultures
Si nous
considérons la Culture comme une conception de vie, qui s’est déjà
infusée et traduite dans le style de la vie d’une communauté humaine,
nous serons en mesure de suivre l’évolution d’une culture depuis son
origine jusqu’à son plein développement, depuis sa grandeur jusqu’à sa
décadence.
Nous
pouvons dire que grosso mode la vie d’une Culture évolue en 5 stades
successifs.
1.
Premier stade: Naissance
Toute
Culture tire nécessairement son origine d’un système religieux ou
philosophique, autrement dit, d’une idéologie, d’une perspective de
l’existence humaine.
De tout
temps, les promoteurs d’une Culture ont toujours une conception spéciale
de la vie, une perspective déterminée de l’existence humaine.
Ils
veulent qu’on vive de telle ou telle manière, qu’on organise la société
de telle ou telle façon – la seule idéale à leurs yeux.
2.
Deuxième stade: Croissance
C’est à
stade qu’on doit exprimer, concrétiser les conceptions nouvelles et les
adapter à la vie des hommes, en utilisant tous les moyens de diffusion,
y compris littérature et arts au risque d’une lutte et en dépit des
oppositions et des contraintes.
3.
Troisième stade: Plein développement
C’est le
stade où tous les organismes d’ordre matériel et spirituel, individuel
et social auront pris forme, auront été organisés conformément au plan
conceptuel et idéologique donné.
4.
Quatrième stade: Stabilisation
C’est le
stade où l’on fait état des résultats acquis, où l’on défend à n’importe
quel prix, les organismes et institutions déjà créés, les considérant
comme des biens absolus, sacrés, intangibles. Ainsi de persécutés, les
adeptes de la Culture nouvelle deviennent facilement des persécuteurs.
Ce stade
est aussi celui de la vie conditionnée, des habitude et du conformisme.
À ce stade, toutes les forces vives ont perdu leur vigueur.
5.
Cinqième stade: Décadence
La Culture
jadis pleine de vitalité, se trouve maintenant viciée par les moyens de
contrainte, chargée de chaînes.
Elle ne
cadre plus avec la vie réele de l’homme, elle se révèle incapable de
résoudre les problèms actuels de la vie, incapable de mettre fin aux
inquiétudes et aux tourments actuels de l’homme. On commence à douter, à
dégoûter de cette forme de culture, à vouloir la reviser, la réformer
partiellement ou totalement.
☸
Dans
l’étude de la culture, certains se préoccupant de la perspective idéale
qui prime à l’origine d’une culture, définissent la Culture comme un
idéal.
D’autres
étudient seulement la Culture au point de vue pratique et réaliste,
c’est-à-dire quand elle est déjà incarnée dans la vie quotidienne de
l’homme avec toutes ses caractéristiques. Ils considèrent alors la
culture comme l’ensemble de tout ce qui rend la vie digne d’être vécue,
comme l’ensemble des coutumes, des festivités, des réjouissances et des
distractions publiques…
B.
Les trois formes culturelles au cours des âges
Si nous
étudions l’histoire de l’humanité d’une manière superficielle, nous
croyons qu’il y a des milliers de cultures différentes, et nous voulons
dire avec Henri de Man: «Il y a autant d’ordres culturels que de
communautés où l’on croit à une hiérachie de valeurs différentes.»
[73]
Cependant,
si nous nous donnons la peine de comparer entre elles les différentes
formes de culture, si nous les serrons de plus près, nous verrons que
toutes les cultures du monde se ramènent à quelques formes culturelles
principales.
Plusieurs
hommes de culture ont déjà cherché à classifier les cultures.
J. Toynbee
par exemple, en se basant sur des critères nationaux et raciaux,
dénombre en tout et pour tout 21 ou 26 groupes différents de cultures.[74]
Spengler
et Sorokin, de leur côté, se basent sur les tendances et les capacités
d’un peuple pour diviser les cultures en 3 groupes principaux.
Ainsi,
selon Spengler, il y a: la culture Apollinienne ou divine; la culture
magique; et la culture Faustique ou technique.[75]
Sorokin lui répartit la Culture en 3 groupes: Culture spirituelle,
Culture intermédiaire, Culture matérielle.[76]
A mon
avis, les cultures pourraient être aussi réparties en 3 groupes, basés
sur les conceptions cosmogoniques et humaines comme sur les buts et les
perspectives des différentes époques:
a.
Premier groupe: La culture divine ou la culture spirituelle
Cette
forme culturelle vise à enseigner à l’homme une méthode efficace pour
réaliser une vie spirituelle, sur naturelle et parfaite. Elle enseigne
donc la voie des Saints, des Boudhas, des Dieux, brefs des hommes
parfaits dont les dénominations varient selon les temps et les lieux.
C’est la voie des dieux, la Culture des Dieu.
b.
Deuxième groupe: La Culture humaine
Cette
forme culturelle s’efforce de rénover, de transformer l’âme et
l’intelligence humaines.
Elle aide
les hommes à évoluer, à mener une vie noble et digne. C’est la voie des
hommes, la Culture humaine.
c.
Troisième groupe: La Culture technique ou matérielle
Celle-ci
prône la rénovation de la vie sociale, l’organisation de la vie
nationale, de l’économie, de la technique, de la vie matérielle du
peuple. C’est la culture matérielle.
On peut
dire que cette division des cultures repose sur des critériums solides.
Tout
d’abord, elle repose sur la conception tripartite de l’homme.
Etymologiquement, elle correspond aux trois définitions du mot «Culture»
de la langue latine.
1. Culture
de la terre (Agricultura ou Agricultus).
2. Culture
de l’homme (animi cultura ou animi cultus).
3.
Cultures des dieux (Dei cultura ou Dei cultus)
Elle
correspond à la conception tripartite du macrocosme et du microcosme du
Yiking, et de la philosophie orientable:
- Dieu, Homme, Terre
(Nature)
- Esprit, Âme, Corps.
On aura
encore reconnu dans cette division le schéma des trois ordres selon
Pascal:
- le monde de la charité.
- le monde de l’esprit.
- le monde
de la chair.1
Avec leurs
modes respectifs de connaissance, à savoir:
- l’intuition ou
l’illumination.
- La connaissance
discursive.
- La
connaissance empirique.[77]
Elle
correspond encore à la conception tripartite de l’homme professée par
plusieurs écoles philosophiques occidentales anciennes. Les Valentiniens
par exemple, répartissent les hommes en 3 groupes:
- les spirituels ou divins.
- les psychiques ou humains.
- Les
hyliques ou matériels.[78]
Il est à
noter que chaque peuple a une prédilection et une prédisposition pour
une forme culturelle donnée.
Ainsi
d’après J. Laloup, «l’Inde s’est évadée vers l’approfondissement des
mystères de l’homme et de Dieu. La Chine a cultivé spêcialement l’art
difficile des relations humaines. L’Occident s’est spécialisé dans la
connaissance et la domination du monde matériel»
[79].
Personnellement, je pense que l’Orient serait versé davantage dans le
Divin; le Proche Orient et le Monde Méditerranéen s’occupe plutôt de ce
qui est humain; l’Europe (Septentrionale et Atlantique) et l’Amérique se
sont spécialisées dans la connaissance et la domination du monde
matériel.
Tout
naturellement, ce ne sont là que des hypothèses de recherche; des
distinctions factices pour nous permettre de voir plus clair, de
comprendre plus facilement le problème. Mais la réalité est autrement
plus compliquée.
Creusons
davantage:
I.
La première culture est la culture spirituelle et divine
(déjà réalisée comme nous l’avons vue en Inde, en Chine, en Égypte
antique). Pour elle:
- L’Univers et l’homme sont
l’expression, la manifestation de l’Absolu.
- Il s’ensuit que l’homme a
une origine divine, et qu’il est de nature divine.
- L’homme
peut donc devenir un dieu, s’il sait s’instruire et se perfectionner.[80]
- Sur le plan religieux,
cette culture met l’accent sur la méditation, la concentration,
l’illumination, ou la gnose, soutenant que le salut ne s’obtient que
grâce à la gnose et à l’auto-perfectionnement.
- Au point de vue
politique, cette culture professe que Dieu gouverne le monde par
l’entremise des Saints-Rois (Théocratie). Ceux-ci devraient être donc
des modèles de perfection pour le peuple. Ils sont à la fois chefs
politique et chefs religieux (Rois-Pontifes).
Une fois
mise en pratique sur une grande échelle, cette forme culturelle prend
deux expressions différentes:
1. Un
petit nombre d’adeptes et de disciples parviennent en fait à
l’illumination, parviennent en fait à se sanctifier, à se diviniser.
C’est l’ésotérisme ou l’hermétisme.
2. La
majorité des gens au contraire exercent simplement le culte rituel de
Dieu ou des dieux; tâchent de mener une bonne vie, dans l’espoir de
rémunération ou par peur des sanctions dans ce monde ou dans l’au-delà.
C’est l’exotérisme.
Entre ces
deux expressions-limites, il y a place pour spiritisme, magie,
talismans, incantations, amulettes … dans le but de se mettre en
relation plus ou moins directe avec les esprits, de commander aux
éléments ou de tirer profit de la crédulité du peuple.
Théoriquement, cette forme de culture est la plus haute; mais
pratiquement, très peu d’hommes sont en mesure de la bien comprendre et
de la réaliser.
Quant à la
masse, elle ne fait que compter sur la Providence, sur le sort, et ne
songe pas à se développer, à devenir forts et libre, à s’émanciper.
Bien plus,
cette culture tend à négliger l’aspect matériel de la vie, le
considérant comme éphémère et illusoire.
On
comprend alors pourquoi la faim et les misères physiques constituent une
menace constante pour les masses vivant sous l’emprise de cette culture.
II.
La deuxième culture peut eâtre considérée comme la culture humaine
(culture humaniste)
Cette
forme de culture considère l’univers et l’homme comme des créatures de
Dieu.
- Au point de vue religieux,
elle soutient que l’homme doit se consacrer au culte de Dieu ou des
dieux (monothéisme ou polythéisme), faire le bien, éviter le mal, et
cela à cause des sanctions de l’au-delà.
Et comme
l’au-delà est au premier rang de ses préoccupations, cette culture
n’attache pas beaucoup d’importance à la vie actuelle ou temporelle.
- Au point de vue moral,
elle encourage la pratique des vertus, préconise la bonne entente
humaine, en même temps qu’une vie digne et noble.
- Au point de vue politique,
cette culture fait une distinction entre pouvoir spirituel et pouvoir
temporel.
Les
dirigeants politiques et religieux tout à tour se partagent ou se
disputent le pouvoir sur le peuple, le monopole d’exploitation du
peuple.
Cette
culture met l’accent sur les relations entre homme et Dieu, entre homme
et homme, entre église et état. Mais elle aussi n’attache pas
d’importance aux problèmes économiques et matériels, c’est pourquoi elle
n’offre pas de solutions adéquates aux problèmes que posent la misère
physique et la corruption sociale.
III.
La 3ème forme culturelle est la culture matèrielle et technique
Elle
écarte à priori et considèrent comme non avenus les problèmes de la
création, de l’existence de Dieu.
Loin de se
tourmenter des problèmes d’ordre surnaturel, religieux et métaphysique,
elle s’en tient aux questions sociales, économiques, industrielles et
utilitaires.
Elle n’est
ni spirituelle, ni sentimentale, mais elle se veut réaliste et
utilitaire. Elle ne rêve pas de la vie future, de l’au-delà, mais
s’efforce d’améliorer, de transformer la condition de l’homme actuel,
d’améliorer la vie sociale actuelle, l’orientant vers un standard de vie
matérielle et collective meilleur.
Pour elle,
l’individu est partie intégrante de la société et dépend totalement de
la société.
Tous les
problèmes doivent être étudiés, délibérés. Tous les efforts doivent être
canalisés vers la réalisation d’une société puissante, égalitaire et
juste.
Ce qui
revient à dire que toutes les questions relatives à Dieu, à la religion
doivent être délibérément écartées. On ne se préoccupe que des problèmes
utilitaires de la vie présente et des progrès techniques.
Dans les
sociétés préconisant cette forme culturelle, seules la science, la
technique et l’efficience sont prises en considération.
- Au point de vue économique
et commercial, cette forme culturelle admet ou la libre concurrence ou
l’économie dirigée. Cela dépend des vues et des dispositions de la
nation sectaire.
*
Trois formes culturelles: Trois conceptions différentes de la nature
humaine.
Les trois cultures:
- Culture spirituelle ou
divine,
- Culture humaine ou
psychologique,
- Culture matérielle ou
économique,
se sont
édifiées chacune respectivement sur une conception différente de
l’homme.
- La
culture spirituelle est partisane de la conception tripartite de
l’homme.
Pour elle,
l’homme est tripartite, et possède:
+ esprit
+ âme
+ corps.
Pour elle,
Dieu n’est pas éloigné de l’homme. En effet, Dieu réside dans le
sanctuaire de l’âme. Inutile donc de chercher Dieu dans des temples
faits de mains d’homme,[81]
inutile de le chercher hors du temple de l’âme.[82]
Elle soutient que l’homme une fois accédé à l’illumination, à la gnose,
dépasse en valeur, religion et société.
- La
culture psychologique ou humaine est partisane de la conception dualiste
ou binaire de l’homme. Pour elle, l’homme est corps et âme.
Pour
trouver Dieu, pour être en communication avec les esprits il faut
fréquenter les lieux de culte, il faut recourir aux rites et cérémonies
sacramentelles, il faut se fier à l’égise des pasteurs et cela
indéfiniment depuis la naissance jusqu’à la mort.
C’est
pourquoi, l’homme doit se subordonner à la religion institutionnelle,
étant lui-même considéré comme incapable de faire son propre salut. Il
ne peut avoir d’opinions contraires à un certain nombre de dogmes
considérés comme des vérités intangibles et éternelles; il doit se
soumettre complètement à la hiérarchie ecclésiastique.
- La
culture matérielle ou technique est partisane de la conception unitaire
de l’homme. Pour elle, l’homme n’est que chair. Il n’y a pas d’âme. Il
n’y a que vie présente. Pas de vie future!
Dans ces
conditions, l’homme n’a pas besoin de religion, il n’a pas à se
préoccuper des problèmes de l’au-delà; mais qu’il se consacre à
l’organisation, au perfectionnement de sa vie présente, de sa vie
terrestre.
- La
culture technique peut résoudre de nombreux problèmes matériels, sociaux
et humains, mais poussée à la limite, elle pourrait renier à l’homme ses
droits à la liberté, à l’indépendance et l’obligerait à se soumettre
entièrement à la collectivité, au parti, à la classe dirigeante.
-
L’évolution culturelle au cours de temps
À notre
avis, ces trois formes culturelles, spirituelle, humaine, matérielle se
sont succédées dans le temps.
L’histoire
du genre humain semble se dérouler progressivement de l’esprit vers la
matière, de l’intérieur vers l’extérieur, de l’individu vers la société;
du droit divin au droit humain puis aux lois physiques; de la conception
d’une vie individuelle et libre, à la conception d’une vie collective,
savamment enrégimentée solidement encadrée dans des institutions
religieuses, sociales, politiques, ou corporatives.
Parvenue
aux confins de la culture et de la civilisation matérielle, l’histoire
rebrousserait chemin, pour s’orienter de nouveau vers une culture
humaine puis spirituelle, cette fois-ci mieux comprise, et autrement
plus efficace.
L’avenir
nous réserve encore bien des mystères et des surprises. L’étude des
cultures, basée sur différentes conceptions de la nature humaine nous
aurait suffisamment montré que l’homme peut vivre sur différents plans:
matériel, physiologique, familial, social, psychologique et spirituel.
Bref,
l’homme peut vivre en animal évolué, ou en homme avec toutes les
qualités purement humaines, ou même en dieu, en saint, comme les grands
Initiés de tous les temps.
V.
ESSAI SUR UNE DEFINITION DE LA CULTURE ET SUR UNE CONCEPTION NOUVELLE DE
LA CULTURE
Après
avoir commenté quelques définitions de la Culture, procédé à une étude
étymologique et analytique du mot Culture, esquissé l’évolution de la
culture, et enfin décrit les trois formes culturelles au fil des temps,
il convient, croyons-nous de proposer une définition et une conception
personnelle de la culture.
En effet,
avancer une définition de la culture, c’est précisément avancer une
conception de la culture; mais avancer une conception de la culture,
c’est aussi préconiser un certain mode de vie, assigner une certaine
perspective, un certain but à la vie.
Tout
d’abord, pour définir la Culture, il importe, à mon avis, de choisir une
définition extrêmement vivante, ayant une portée étendue, susceptible de
s’adapter à tous les milieux et à toutes les époques.
Partant de
ces considérations, j’en viens à la définition siuvante:
«La
culture c’est l’ensemble des efforts fournis par toutes les générations
humaines pour tendre à la perfection, à une vie idéale, à tous les
points de vue; c’est aussi l’ensemble des œuvres réalisées, des étapes
parcourues sur ce chemin de l’évolution.»
De tout
temps, les cultures se sont différenciées précisément à cause des
conceptions différentes quant à l’idéal, à la vie idéale, à la condition
humaine, à la destinée humaine.
Positivement parlant, la culture est une manière de penser et de voir;
une foi, une vision de la condition et de la destinée humaine,
imprégnant, exaltant et orientant la vie d’une société ou d’un peuple.
Cette
conception de la vie, cette foi en l’avenir, c’est présément cette
flammme divine qui rallume notre enthousiasme, qui éclaire notre
intelligence, qui nous montre le sens du progrès, l’objectif à atteindre
et à réaliser.
C’est
pourquoi, gardons-nous de concevoir la culture d’une manière
superficielle, la faisant équivaloir à la littérature, aux arts, à
l’éducation ou à un mode quelconque de vie. Ce faisant nous abordons
encore intact son côté profond et spirituel.
En effet,
la littérature et les arts peuvent être envisagés sous des angles très
différents: il y a littérature et art de plaisance; il y a littérature
et art visant à montrer la voie au peuple, aux nations, au monde entier.
De même,
il y a éducation et éducation; et cela en fonction des critères et des
buts fixés au préalable.
De même en
parlant des modes de vie, il convient d’en préciser les bases
idéologiques et les lignes de conduite: vie stagnante ou vie de lutte;
conservatisme ou révolution; traditionalisme ou criticisme; vie en
profondeur ou vie en surface; statu quo ou progrès; introversion et
spiritualité ou extraversion et poursuite matérielle.
En résumé,
il importe de chercher, de découvrir l’âme de la culture ainsi que les
ressorts et les mécanismes cachés qui en commandent la forme et le
comportement extérieur.
Un
véritable artisan de la culture doit avoir un esprit fin et perspicace,
une conception judicieuse de la vie, une orientation idéale.
Il lui
faut de l’exaltation quan il s’agit de réaliser son idéal, ou
d’insuffler l’enthousiasme au autres.
Pour moi,
la culture est perspective de l’avenir plutôt que souvenir du passé.
La Culture
doit être l’expression des efforts créateurs, constructifs et non pas
simple attitude de jouissance et de conservation.
Si nous
comprenions la Culture comme des efforts du genre humain pour atteindre
un mode de vie idéal à tous les points de vue, nous devrions préconiser
une culture globale et totale avec des idées de base claires et nettes
sur la vie humaine et sur les méthodes propres à la réalisation d’une
pareille vie.
Une
culture qui préconise une vie parfaite sous tous les rapports pour
l’individu, pour l’humainté, ne peut négliger, ni écarter aucun des à
côtés, aucun aspect de l’homme. Au contraire, elle doit tenir compte de
tout ce qui touche à la vie humaine, c’est-à-dire tous les facteurs
matériels et spirituels, psychologiques et physiologiques, religieux et
politiques.
En
étudiant les cultures orientales et occidentales, anciennes et modernes,
nous avons remarqué qu’il y a:
- des nations, des
époques qui attachent de l’importance aux questions d’ordre spirituel; à
la culture psychique et spirituelle pour atteindre l’illumination et la
délivrance.
- des nations, des époques
qui attachent de l’importance aux ques tions d’ordre psychologique et
humain, visant à former l’homme avec toutes les qualités inhérentes à
son titre d’homme.
- des nations, des époques
qui accordent de l’importance aux problèmes scientifiques,
économiques, sociaux et nationaux.
Ces faits
historiques nous montrent que l’homme pourrait vivre sur trois plans,
différents:
- plan divin, spirituel
(culture divine ou spirituelle)
- plan humain (culture
psychologique ou humaine)
- plan physique ou matériel
(culture matérielle ou technique)
La
Culture Spirituelle comme nous
l’avons vu, a pour but de purifier, de sanctiffier l’homme, d’infuser à
l’homme la foi en ses potentialités énergétiques. Mentales et
spirituelles.
Mais cette
culture étant trop sublime, ne pourrait être appliquée à la masse dont
les capacités encore limitées et restreintes l’empêchent d’y accéder.
N’étant
point en mesure d’en pénétrer l’essence, la masse se laisse vivre, se
contentant de la lettres et des symboles de la doctrine divine.
De ce
fait, la masse devient la proie facile pour les superstitions.
Tournant
le dos à la vie matérielle, la culture divine ne saurait résoudre de
façon efficace les problèmes de l’existence matérielle de la masse.
C’est là le revers de cette culture.
Toutes ces
imperfections ont conduit les philosophes et les dirigeants spirituels à
réfléchir sur la nécessité de rechercher pour la masse une doctrine qui
lui convienne mieux, une doctrine qui s’attache à l’œuvre de formation
et d’éducation de la masse sur le plan moral et social: d’òu rites et
protocoles faciles à suivre, vulgarisation de l’enseignement, corps
enseignant et autorités hiérarchiques pour tous les échelons et les
classes.
Cette
culture humaine a pu satisfaire la masse dans une certaine mesure.
Toutefois, pour intensifier la propagation de la doctrine, pour mieux
s’assurer l’adhésion de la masse, on a étê parfois amené à user des
mesures de contrainte barbares et cruelle.
Bien plus,
voulant à tout prix standardiser les gens, on a étouffé la liberté
spirituelle, on a brisé l’élan créateur à bien des âmes exceptionnelles.
Pis
encore, on en est arrivé jusqu’à ignorer, à obnubiler ce qu’il y a de
sulblime chez l’homme l’esprit.
Cette
culture au reste, est loin de résoudre de façon concrète les injustices
humaines, d’éviter à l’homme les cruautés, les misères, la famine, les
maladies dont il souffre. Certes il existe des organisations de charité
et de bienfaisance qui portent secours dans les cas urgents, mais tout
cela n’est pas de nature à exalter la dignité humaine. C’est là le
revers de la Culture Humaine.
C’est
pourquoi, on en vient à entreprendre des œuvres de rénovation sociale
dans le but de réduire au minimum les privations et les misères qui
accablent l’homme et de lui assurer une vie plus confortable. C’est
l’ère de la Culture Matérielle.
Cependant
celle ci a aussi son point faible. En effet, elle ne tient pas compte de
la dignité de l’homme; elle se révèle cruelle, astucieuse, intriguante;
elle enferme l’homme dans des cadres extrêmement étroits et rigides,
voire même supprime sa liberté.
On donne à
l’homme son pain quotidien, mais on lui retire la liberté et la dignité.
Aussi, de
toutes parts dans le monde, se sont maintenant élevés des S.O.S. «Qui
nous délivrera de la mécanisation, et du conditionnement?»
À bien
réfléchir, toutes les cultures ont leurs avantages et leurs
inconvénients, leurs mêrites et leurs défauts.
Notre
devoir est donc de rechercher une nouvelle conception de la culture, une
nouvelle culture, une culture vivante qui puisse s’adapter à toutes les
circonstances de la vie, une culture polyvalente, à la fois sublime et
réaliste, à la fois idéale et pragmatique qui puisse satisfaire les
aspirations des hommes de toutes les classes, de tous les âges; qui
puisse évoluer avec l’histoire, sans risque d’être éliminée, qui
s’adapte aux progrès son ultime objectif; à savoir mener une vie divine
et idéale dans un monde parfait, dans une société de, l’âge d’or à
venir.
Une telle
culture setait naturellement une culture totale, parfaite à tous les
points de vue.
Elle sera
la synthèse des trois cultures:
-
divine ou spirituelle.
-
humaine ou sociale.
-
matérielle ou technique.
sélectionnant ce qui est bon et éliminant ce qui est mauvais dans les
formes culturelles passées.
Cette
culture totale a pour but de mettre en lumière et de développer toutes
les valeurs, toutes les potentialités de l’homme sur tous les plans, de
lui assurer des conditions spirituelles et matérielles favorables au
plein développement de leurs facultés d’édifier un société d’entraide
mutuelle, heureuse et juste, bref, procurer à l’homme toutes les
conditions favorables pour vivre dans le bonheur, un bonheur sans
mélange, exempt de soucis, de misères, de maladies, et finalement pour
arriver à se sanctifier, se diviniser.
Pour
édifier, pour réaliser une culture totale, nous pouvons d’ores et déjà
envisager quelques principes directeurs fondamentaux:
1. En
premier lieu, il faut être persuadé que l’homme a une origine divine,
une nature divine[83]
et de ce fait, a la possibilité d’évoluer indéfiniment.
2. En
second lieu, il faut savoir que le beau, le parfait existent déjà à
l’état latent chez l’homme. Par conséquent, les organisations
religieuses et sociales n’ont qu’à faire épanouir et développer ces
germes du vrai, du bien et du beau enfouis au plus profond de l’homme.
Ces
considérations mènent à des conclusions pratiques extrêmement
importantes, à savoir:
- Respect de la dignité
humaine.
- Instauration de l’esprit
de solidarité, d’entraide et de compréhension chez l’homme.
- Libération effective de
l’homme, reconnaissant à l’homme parvenu à l’illumination le droit de
transcender les cadres institutionnels des religions.
L’homme en
fin de compte est maître; toutes les religions institutionnelles ne sont
que des instruments temporaires.
L’homme
doit se servir de la religion comme d’un instrument pour son évolution,
comme une méthode pour se sanctifier. Qu’il ne soit pas esclave des
institutions religieuses et des autorités ecclésiastiques.
3. En 3ème
lieu, nous reconnaissons que nos ancêtres ont découvert et établi, au
prix de mille labeurs, les vertus éminentes de l’homme: charité,
justice, courtoisie, sagesse, loyauté, équité, intégrité, noblesse d’âme
etc …
Toutes ces
belles et hautes qualités ont besoin d’être sauvegardées, encouragées,
développées par tous les instruments de culture disponibles:
littérature, théâtre, art, musique etc …
Une nation
qui compte de nombreux hommes d’élite est comparable à une maison pleine
de pierres précieuses, à un jardin couvert de fleurs odorantes. Si tout
le monde possède une âme pure et noble, il n’y aura plus ni guerres, ni
dissensions, ni luttes.
4. En 4ème
lieu, nous reconnaissons que l’homme ne saurait vivre séparé de son
corps, de son milieu, de la société.
C’est
pourquoi, tous les problèmes sociaux, politiques, économiques, ceux qui
se rapportent surtout à la nourriture, et à l’habillement, sont autant
de problèmes vitaux qui exigent des solutions adéquates.
Évidemment, l’homme n’est pas un pur produit de la société, pas plus
qu’il n’est un pur instrument de la nation. Il a la possibilité et le
droit de s’élever au-dessus des cadres historiques, sociaux et
nationaux.
En somme,
la société et l’histoire ne sont que des milieux et des instruments dont
se sert l’homme pour s’élever.
5. En 5ème
lieu, nous pensons que l’homme, s’il le veut réellement, pourra réagir
avec succès contre toutes les inégalités, les injustices, les
corruptions sociales.
L’histoire
prouve que si l’homme veut bien se donner la peine de réfléchir, s’il
veut se livrer à des recherches, il vaincra la famine, les misères, les
maladies, il améliorera sa vie, augmentera son bien-être, son confort
grâce à la technique, à la science, à la machine.
Tous les
fléaux sociaux pourraient être éliminés, si les pouvoirs publics y
mettaient leur volonté, si tous les hommes conscients de leurs droits et
de leur valeurs, et de leur mission coopéraient à améliorer leur sort.
6. En 6ème
lieu, nous admettons que l’homme peut évoluer indéfiniment, évoluer de
la bête à Dieu.
C’est
pourquoi, il doit être instruit, guidé, il doit progresser toujours
davantage.
Pour vivre
intensément, il nous faudra de hautes visées, de beaux idéals.
«Élevons-nous!
Regardons
toujours plus haut!
Plus
l’idéal est élevé, plus la vie est intense.
Une vie
vulgaire ne peut ni galvaniser notre caractère, ni former notre esprit.
Une vie
banale est une vie en voie de dégradation.
Se borner
à contempler la vie est l’attitude d’un enfant.
Donnons
toute notre mesure: nos semblables ont leur regard tourné vers nous.
Déployons
nos efforts, car le pays a besoin des héros.
Le pays
attend de nos mains créatrices une œuvre d’embellissement, de
rénovation.
Inaugurons
une vie glorieuse,
Vivons
pour la grandeur du pays.
Peinons,
travaillons sans relâche!
La terre
tremble-t-elle, le ciel s’effondre-t-il, la mer se dessèche-t-elle, les
montagnes s’écoulent-elles, notre volonté de fer sera toujours
inébranlable.»
7. En 7ème
lieu, nous admettons que la réalité actuelle n’est jamais parfaite.
Elle n’est
que le maillon d’une chaîne qui nous conduira vers l’idéal. S’en tenir à
la réalité actuelle, prôner la réalité actuelle, s’extasier devant les
modes de vie actuels, c’est commettre une grave erreur.
Le devoir
de tout homme est de savoir juger, de reviser ses points de vue, ses
méthodes, de tendre ses efforts vers une constante amélioration.
«Rénovons nous, rénovons nous toujours, rénovons nous sans relâche» (La
Grande Étude, cha. 2 de la 2ème partie. Commentaire de Tseng Tzeu).
8. En 8ème
lieu, nous admettons que l’homme est complexe. Il n’est ni esprit seul,
ni âme seule, ni corps seul. C’est pourquoi, il ne faut pas se prononcer
indéfiniment pour ou contre l’esprit, pour ou contre la matière. Il faut
par contre se montrer souple et ondoyant.
Dans la
pauvreté par exemple, l’homme doit penser naturellement davantage à
gagner sa vie quotidienne. Mais parvenu à l’aisance, il doit au
contraire, se tourner davantage vers les problèmes d’ordre psychologique
et spirituel.
Cela
revient à dire, que les mobiles de l’histoire sont multiples. L’histoire
est la résultante des forces divines, humaines et matérielles et nonla
manifestation d’une cause secondaire unique, comme certains le
soutiennent fallacieusement.
9. En 9ème
lieu, nous pensons que l’homme doit avoir un esprit ouvert,
compréhensif, avide de progrès, sachant distinguer les points forts
d’autrui et reconnaître ses points faibles, pour pouvoir s’adapter à
toutes les éventualités, à toutes les circonstances, et progresser
indéfiniment.
10. En
10ème lieu, nous pensons que de tout temps, l’homme a soif de liberté,
de justice, d’idéal et de progrès.
Une
culture parfaite doit répondre à toutes ces aspitations de l’homme. Elle
doit être une culture ouverte et non une culture close; elle doit
réserver des échappatoires pour les hommes plus évolués, qui ont la
ferme volonté de progresser, de s’élever, de vivre à un niveau supérieur
à celui du commun des mortels.
Le culture
doit être un moyen pour l’homme de progresser et non une cangue, une
chaîne qui le serre et l’enchaîne.
11. En
11ème lieu, nous pensons que les idées dirigent les actions, que l’idéal
proposé doit avoir pour but de transformer et d’idéaliser la réalité. Si
les idées n’étaient pas mises en pratique, si l’idéal ne s’incarnait pas
dans la vie, alors les idées ne seraient que chimères, l’idéal ne serait
qu’illusion et utopie.
12. En
12ème lieu, nous soutenons qu’en théorie comme en pratique, tous les
efforts de l’homme doivent servir à:
- Transformer et améliorer
la situation matérielle.
- Développer l’intelligence
et les facultés de l’homme.
- Améliorer l’âme humaine.
- Aider l’homme à se
développer, à s’élver spirituellent au niveau surhumain, au niveau
divin.
Ces
principes une fois mis en pratique, nous conduisent aux considérations
et conclusions suivantes:
1.
Actuellement, l’histoire et la science nous montrent que les hommes ont
la possibilité de résoudre tous leurs problèmes matériels et de
satisfaire tous leurs besoins matériels; que l’homme peut se rendre
maître de la nature et du milieu environnant grâce à l’organisation et à
la technique.
Dans ces
conditions, pourquoi n’utiliserons-nous pas toutes les inventions de la
scidnce, toutes les possibilités techniques pour:
- Exploiter à fond les
ressources naturelles,
- Industrialiser le pays,
- Électrifier la campagne,
- Mécaniser l’agricultute,
- Développer les voies de
communication et améliorer les moyens de transport,
- Planifier et embellir les
villes…
Parallèlement à ces travaux de réforme et d’édification, les problèmes
sociaux devront être réexaminés et résolus de manière que tous les
hommes puissent vivre dans l’amour, dans la justice, dans l’honneur,
étant entendu que les questions de l’éducation, de la formation des
cadres, des techniciens, des élites, des hommes supérieurs sont au
premier plan de nos préoccupations.
Sur le
plan spirituel, les religions ne doivent pas trop s’attacher aux formes
extérieures (rites et cérémonies), mais elles doivent creuser davantage
les problèmes dogmatiques et cela dans des séances d’étude publiques,
dans des conférènces débats; s’occuper davantage des problèmes de
raffinement et de sanctification de l’homme.
Dans cette
perspective d’avenir, la majorité sinon tous les hommes, euraient acquis
de vastes connaissances; jouissant de l’aisance matérielle et de la paix
spirituelle. Ils vivraient dans l’amour, dans la fraternité, dans une
compréhension réciproque sans hypocrisie, sans trahison. Tous
s’efforceraient de s’améliorer de progresser, de se créer une vie belle,
poétique et digne.
Chaque
famille deviendrait un centre d’entraînement pour ses membres et les
parents auraient la responsabilité de guider, d’éduquer leurs enfants,
en les aidant à comprendre ce que serait une vie idéale et la necessité
pour eux de déployer leurs efforts pour parvenir à une vie idéale.
Les
pouvoirs publics auraient la mission de faire régner la paix et la
prospérité dans le pays, de conduire le peuple vers le progrès; ils
devraient s’attacher à l’œuvre de formation des hommes de talents, des
hommes supérieurs dont ils utiliseraient les services.
En même
temps, ils utiliseraient les inventions de la science, les techniques
pour exploiter les ressources naturelles, créer et développer des
entreprises de transports maritimes et aériens, des échanges commerciaux
avec les puissances étrangères, de telle sorte que le pays devienne
fort et prospère et que ses habitants puissent se montrer fiers d’être
de bons sujets d’un beau pays.
Ainsi une
culture totale englobe tous les efforts que déploie l’homme pour
parvenir à une vie idéale et tous les résultats obtenus par ces efforts.
Nous
disons, vie idéale, parce que les cirsonstances de la vie et la nature
serviront l’homme et ne seront plus pour lui un obstacle ou un ennemi.
Nous
disons vie idéale, parce que l’homme a désormais un corps sain et bien
développé, qu’il peut suffire largement à ses besoins et cela
facilement, sans trop de peines, grâce aux méthodes scientifiques, et
aux machines.
Nous
disons vie idéale, parce que la vie intérieure et spirituelle de
l’homme, une fois bien guidée, pourrait atteindre son plein
développement.
Ainsi
l’homme cultivé est celui qui a déloyé tous ses efforts pour combattre
les vices, les inégalités sociales, afin de réaliser pour soi-même et
pour ses semblables une vie belle, radieuse, noble, parfaite.
Cette
vision de l’avenir, d’où vient-elle?
Elle vient
de notre for intérieur.
Et où
prendrons-nous les moyens de réalisation de cet avenir?
Nous les
prendrons dans notre cœur, dans notre cerveau, dans nos membres et dans
la coopération de tous.
Cette
vision de l’avenir pourrait se concrétiser, se réaliser, si tout le
monde unissait ses efforts, œuvrait selon des méthodes, des directives
appropriées, des organisation adéquates.
Si tous
nous étions conscients de notre mission, si nous faisions des efforts
pour progresser sans relâche, nous parviendrons sans nul doute à tenir
ferme non seulement le gouvernail de notre nation, mais aussi celui de
l’humanité pour l’orienter vers l’avenir divin et radieux comme l’a
prédit Victor Hugo dans ces vers:
«Ou
va-t-il ce navire? Il va de jour vêtu,
À
l’avenir divin et pur, à la vertu,
À la
science qu’on voit luire,
Il va
ce glorieux navire,
Au
juste, au grand, au loin, au beau, vous voyez bien
Qu’en
effet, il monte aux étoiles …»
(Plein Ciel)
Isaie et
Jérémie, depuis bien longtemps, avaient aussi envisagé et décrit cet
avenir divin. Voici ce qu’ils disent: «…Car je vais créer des cieux
nouveaux et une terre nouvelle, et l’on ne souviendra plus du passé, qui
ne remontera plus au cœur. Qu’on soit dans la jubilation et qu’on se
réjouisse de siècle en siècle de ce que je vais créer, car je vais créer
Jérusalem «Joie» et son peuple «Allégresse». Là plus de nouveau-né qui
ne vive que quelques jours, ni de vieillard qui n’accomplisse pas son
temps.
«Mourir à
cent ans, c’est mourrir jeune, et ne pas atteindre cent ans sera signe
de malédiction!
«Ils
bâtiront des maisons qu’ils habiteront, ils planteront des vignes dont
ils mangeront les fruits, Ils ne bâtiront plus pour l’habitation d’un
autre, et ne planteront plus pour la consommation d’un autre. Car la
durée de mon peuple sera telle que la durée des arbres, et me élus
useront ce que leurs mains auront fabriqué. Ils ne peineront plus en
vain, ils n’auront plus d’enfants destinés à leur perte …
«Car ils
seront une race bénie de Yahvé, ainsi que leur descendance.
«Avait
même qu’ils appellent, je leur répondrai, ils parleront encore qu’ils
seront déjà exaucés. Le loup et l’agneau paîtront ensemble, le lion
mangera la paille comme le boeuf et le sepent se nourrira de poussière.
On ne fera plus de mal ni de ravag sur toute ma sainte montagne, dit
Yahvé …»
«… Voici
venir des jours – oracle de Yahvé – où je concluerai avec la maison
d’Israel (et la maison de Juda) une alliance nouvelle. Non pas comme
l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères.»
«Je
mettrai ma loi au fond de leur être et je l’écrirai sur leur cœur.
Alors, je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Ils n’auront plus à
s’instruire mutuellement, se disant l’un à l’autre: «Ayez la
connaissance de Yahvé», mais ils me connaîtront tous, des plus petits
jusqu’aux plus grands-oracles de Yahvé – parce que je vais pardonner
leur crime et ne plus me souvenir de leur péché.»
CONCLUSION
En
conclusion, discuter sur la culture, c’est chercher à savoir ce que
l’homme a depuis toujours pensé du Vrai, du Bien et du Beau comment il a
conçu le Vrai, le Bien et le Beau, ce qu’il a pu réaliser de Vrai, de
Bien et de Beau; comment il s’y est pris pour s’orienter vers le Vrai,
le Bien et le Beau.
Jetons un
reagrd global sur les états, les nations, les peuples, les générations.
Que
voyons-vous? L’homme nous y apparaît comme un guerrier héroïque qui,
perdu dans une forêt épaisse, pleine de reptiles, d’animaux féroces, de
ronces et d’épines, en proie à des dangers de toutes sortes, cherche au
milieu de la nuit noire que perce seulement la lumière blafarde des
étoiles, à se frayer une voie pour en sortir, tâche de réaliser ses
espoirs, réussit à accomplir des exploits brillants et glorieux.
Par la
suite, la forêt aura été peu à peu ouverte à l’exploitation; les
reptiles, les animaux féroces auront disparu; le soleil y apparaîtra
avec ses rayons ardents, et l’homme verra que ses travaux, ses labeurs
n’étaient pas dépensés en vain.
Ce qu’il a
cherché en tâtonnant, lui appraîtra d’abord partiellement, puis
totalement.
Son Soi
profond que depuis toujours il a estimé vulgaire et banal, se révèlera à
ses yeux, éclatant dans tous ses traits magnifiques et attrayants.
Dans
l’avenir, l’homme parviendra progressivement à découvrir sa nature
divine, à dominer pour toujours le milieu environnnant, surmonter toutes
les difficultés pour revendiquer et reprendre le rang divin et honorable
qui était le sien.
Disserter
sur la culture, c’est étudier tous les efforts que déploie l’homme pour
atteindre la Vrai, le Bien et le Beau.
En
dissertant sur la Culture, nous avons vu que l’homme peut évoluer tout à
tour dans la sphère divine, dans la sphère humaine, dans la sphère
matérielle et cela soit pour gagner sa vie, soit pour chercher à se
comprendre et comprendre l’Univers; bref, pour créer à lui-même et à ses
semblables, une vie plus belle, plus digne, pour perfectionner son
esprit, son âme, et le milieu dans lequel il vit.
Nous avons
donc le droit d’avoir foi en l’avenir: l’avenir de l’humanité sera
parfaitement beau; il sera d’autant plus beau que l’homme aura des
pensées justes, des actes justes, des efforts justes…
Des
sueurs, des larmes que l’humanité a versées pour dominer le monde seront
des perles et des pierres précieuses qui l’embelliront.
Disserter
sur la Culture, commenter la Culture, c’est vivre la vie de nos
devanciers, c’est comprendre les préoccupations, les inquiétudes, les
angoisses des générations passées; c’est aussi partager les joies de ce
monde; c’est s’inspirer des exemples et de vestiges du passé pour en
tirer des leçons pour le présent et l’avenir; éviter les erreurs et les
fautes commises par nos prédécesseurs, suivre leurs exemples, poursuivre
leur œuvre inachevée, en vue d’améliorer notre vie et celle de nos
semblables, en vue d’édifier un monde meilleur où règneront la paix et
la joie, où les hommes vivront dignement dans le Vrai, le Bien et le
Beau.
S’adonner
à la Culture, c’est rechercher pour soi-même et pour son prochain une
vie digne d’être vécue, un idéal digne d’être suivi; c’est chercher à
comprendre ce qu’est une vie vraie; c’est réfléchir, savoir peser le
pour et le contre, distinguer ler bien et le mal; se refuser à se
laisser transformé en une machine, en un instrument, à se laisser
entraîné par le monde comme une feuille desséchée, ballotée par le vent.
S’adonner
à la Culture, c’est utiliser son temps et ses capacités pour préparer et
édifier l’avenir de son pays, sauvegarder ce qu’on appelle la
quintessence de l’humanité.
S’adonner
à la Culture, c’est exploiter, augmenter nos possibilités corporelles,
nos facultés intellectuelles, morales et spirituelles, pour devenir des
hommes d’élite, des combattants d’avant-garde; c’est nous donner un
idéal élevé.
Pour vivre
intensément, pour vivre en héros, ayons un idéal élevé, orientons-nous
vers un avenir radieux, illimité.
En ces
moments de l’histoire, bon gré mal gré, nous vivons dans une période de
transition où l’humanité est en pleine transformation, où elle est en
train de vaincre tous les obstacles pour s’élever vers le surhumain.
Tous les
obstacles qui se dressent sur le chemin du progrès ont été
progressivement abattus: les montagnes, les mers, les déserts, les murs
du son, la stratosphère ne sauront plus retenir cet élan de l’homme vers
le progrès.
L’Humanité
est train de se métamorphoser, de se transcender par l’eugénisme, par
des autogreffes et des hétérogreffes d’hormones et d’organes, par la
grande offensive déclenchée contre les maladies…
L’humanité
est en train de se métamorphoser, de se transcender grâce à la volonté
de puissance, grâce à la galvanisation de l’âme pour qui l’adversité
n’est plus qu’un pas vers la gloire.
Ainsi en
cette période de la vie, ne soyons pas des hommes faibles, vulgaires,
ignorants; mais soyons des hommes vaillants, actifs, des chercheurs, des
réformateurs.
Toutes les
œuvres culturelles depuis la littérature, le théâtre, les beaux-arts,
jusqu’aux organisations juridiques, morales et religieuses, tout semble
nous inviter à devenir des hommes dignes, des hommes accomplis, à
bénéficier des belles acquisitions de toutes les générations, de tous
les pays pour nous rendre plus parfaits, pour rendre nos compatriotes et
l’humanité entière plus heureux, notre pays et le monde plus beaux, plus
tranquilles, afin que tous puissent enfin vivre des jours prospères et
heureux, se conformant aux lois divines et aux lois morales, mettant à
profit science et technique, dominant complètement la nature.
Toutes ces
belles perspectives sont les vœux que je forme pour vous, Mesdames et
Chères Auditrices, Messieurs et Chers Auditeurs, avant de clôturer ma
causerie sur la Culture…
Saigon,
26-6-1970
Nhân Tử Bác
sĩ
Nguyễn Văn Thọ
CHÚ THÍCH
|